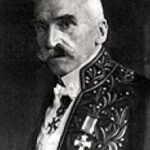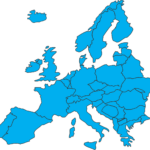En 2016, les Chambres de commerce et d’industrie vont connaître un nouveau plan social. Et si, après les Conseils régionaux il y a plus de 30 ans, les CCI se trouvaient confrontées, aujourd’hui, à des nouveaux concurrents, les clusters (pôles de compétitivité) et l’accès à l’information par les réseaux numériques ? En 1599, est née,…
De « l’ubérisation » des Chambres de commerce par les clusters et l’info numérique
Tendance maintenant