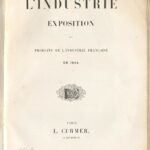Dans l’agitation des transitions énergétiques et numériques, l’anniversaire des épousailles des industries électrique et électronique ne peuvent laisser indifférent. Surtout à un moment où l’avenir des deux filières est en jeu. Il y a 40 ans, le 1er juillet 1975, le Syndicat Général de la Construction Electrique (SGCE) et la Fédération Nationale des Industries Electroniques…
Les industries de l’électrique et de l’électronique fêtent leur 40 ans de mariage
Tendance maintenant