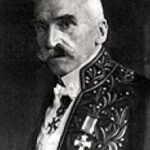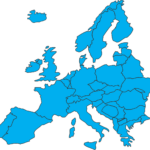Le projet de loi de Ségolène Royal repose plus sur « l’état initial » du fonctionnement énergétique français que sur « la théorie du constructeur » qui ouvre sur les perspectives du « possible ». En 1998, une loi sur les Télécoms a rapidement volé en éclat face à l’innovation. Celle de Royal saura-t-elle protéger « l’état initial » de la production, distribution…
L’innovation « disruptive » et la transition énergétique à la française
Tendance maintenant