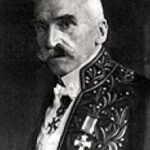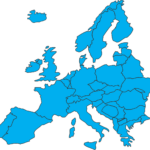Alors que le projet du Grand Paris et ses contrats de développement territorial ont été adoptés, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l’intégration des secteurs concernés par la transformation de Paris-Métropole. (16 novembre 2012) « L’industrie électrique n’est représentée à Saint-Denis que par deux usines de fondation récente.(…). La plus ancienne,…
Les équipementiers de l’électrique grands oubliés du Grand Paris
Tendance maintenant