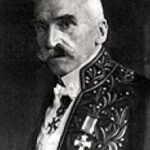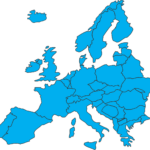Guy Mordret est un témoin essentiel de la crise sanitaire que traverse notre planète. Notamment en se qui concerne la relation entre monde de la recherche dans les biotechnologies et les territoires. Jeune doctorant en biologie marine au début des années 90, il se serait montré d’une grande utilité pour les sciences médicales françaises dans…

Guy Mordret: « En Bretagne, nous avons la chance d’avoir l’océan, réservoir de richesses pour les biotechnologies »
Tendance maintenant