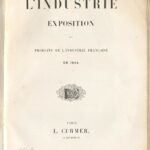La région francilienne est en plein chantier avec le Grand Paris. A l’instant de la transition urbaine par l’impact des nouvelles technologies, il est nécessaire d’avoir le point de vue d’acteurs singuliers de la métropole en devenir. Angela Tandura, dont l’«Atelier Tiresisas » est installé à Rosny-Sous-Bois, exprime à bâton rompu son regard sur l’architecture en…
L’architecte Angela Tandura : « la synergie avec les constructeurs est encore en voie de développement »
Tendance maintenant