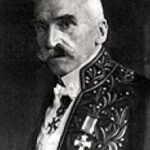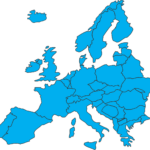Crée il y a plus de 10 ans, prostir.ua est un portail des espaces publics et une plateforme Web multifonctionnelle ukrainienne pour le développement de la société civile. Dans cette étude réalisée par des experts ukrainiens avec le soutien du programme européen U-LEAD, une analyse pertinente du rôle de l’intercommunalité dans les pays du Vieux…
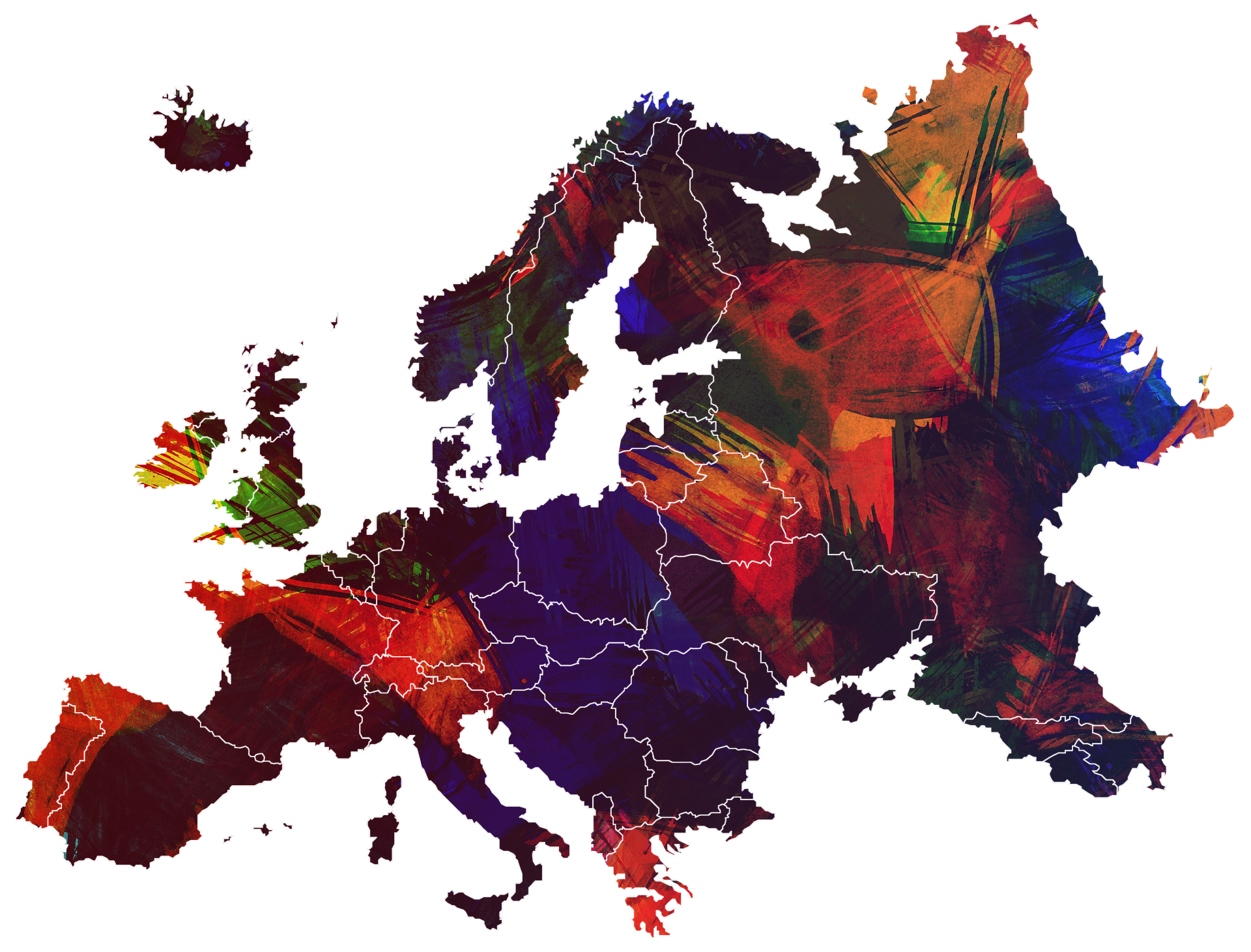
L’intercommunalité en Europe selon une expertise ukrainienne
Tendance maintenant