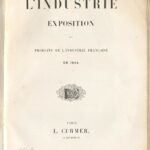Alors que les réunions se multiplient sur l’avenir du transport public dans les territoires urbains et ruraux d’Île-de-France, il semble que les élus locaux n’ont pas encore pris la mesure de l’impact, sur la mobilité des citoyens et la transition climatique, de la révolution numérique actuelle. La Loi d’orientation des mobilités (LOM), présentée la semaine…
Île-de-France : pour une mobilité en phase avec la transition énergétique et numérique
Tendance maintenant